Percy Cayetano Acuña Vigil
Pagina organizada por Percy Cayetano Acuna Vigil, esta dedicada a temas de informacion y de discusion del urbanismo, el planeamiento y la arquitectura, enmarcados por mi vision de la filosofia politica.
Se encuentra usted aquí
Glucksmann André: Acción y producción teórica.
Glucksmann : une oeuvre d'intervention plus qu'une production theorique
Le Monde.fr | 11.11.2015 a 06h47 * Mis a jour le 11.11.2015 a 09h33 | Par Nicolas Weill

Glucksmann: una obra de intervencion mas que una produccion teorica
Le Monde.fr | 11.11.2015 a las 6:47 am * Actualizado 11.11.2015 a las 9:33 am | Por Nicolas Weill
Andre Glucksmann en Paris en junio de 1979.
A pesar de su estilo exaltado, y de la furia heroica a la que su escritura se rindio prontamente, Andre Glucksmann, fallecido el martes 10 de noviembre, estaba, en su obra filosofica, apegado a una corriente que, contrariamente a la metafisica tradicional, dio prioridad al evento de el ser, a la contingencia de la necesidad, al compromiso mas que a la teoria. Se cruzo en el camino de un pensador que provenia de un trasfondo ideologico completamente diferente al suyo en la persona de Raymond Aron. Esto ultimo animo al joven investigador a elegir como objeto de estudio temas inusuales como la disuasion nuclear, la estrategia o la geopolitica, mientras que, en la decada de 1960, la vida filosofica se dividia entre el marxismo, el heideggerismo o el estructuralismo.
Lider de los "nuevos filosofos"
Esto lo llevo, en El discurso sobre la guerra, la teoria y la estrategia (L'Herne, 1967), a interesarse mucho por los pensadores del conflicto, ya sea el Sun Tzu chino (544-496 a. C.) o el aleman. Carl von Clausewitz (1780-1831). Esto lo llevo a retomar uno de los conceptos clave de la Guerra Fria, el del "totalitarismo", en las dos obras que marcaron su ruptura con el maoismo y el marxismo y lo convirtieron en el lider de los "Nuevos filosofos", La Cuisiniere et le eater d'homme (Seuil) y Les Maitres-Penseurs (Grasset, 1977). En esta ultima obra escudrino los origenes de este "mal absoluto" entre los grandes pensadores de Alemania, desde Hegel hasta Heidegger, viendo en el idealismo del otro lado del Rin la causa lejana de las desgracias del siglo XX. Aplaudido por Michel Foucault, este cuadro dejo en su momento a otros escepticos arrepentidos del compromiso comunista, como el historiador Francois Furet.
Luego se las arreglo para explorar el lado oscuro del nihilismo contemporaneo, como en su Dostoyevsky en Manhattan (Robert Laffont, 2002), escrito a raiz de los ataques del 11 de septiembre de 2001. En esto, su trabajo estuvo mas marcado por la intervencion que por una produccion teorica.
Nicolas Weill
Periodista en el mundo
Malgre son style exalte, et les fureurs heroiques auxquelles son ecriture s'abandonnait volontiers, Andre Glucksmann, mort mardi 10 novembre, s'est, dans son oeuvre philosophique, rattache a un courant qui, au rebours de la metaphysique traditionnelle, accordait une priorite a l'evenement sur l'etre, a la contingence sur la necessite, a l'engagement plus qu'a la theorie. Il croisa le chemin d'un penseur qui venait d'un tout autre contexte ideologique que lui en la personne de Raymond Aron. Ce dernier incita le jeune chercheur a choisir comme objet d'etude des themes insolites comme la dissuasion nucleaire, la strategie ou la geopolitique, alors que, dans les annees 1960, la vie philosophique se partageait entre le marxisme, l'heideggerisme ou le structuralisme.
Chef de file des >
Cela l'a amene, dans Le Discours de la guerre, theorie et strategie (L'Herne, 1967), a s'interesser de pres aux penseurs du conflit, qu'il s'agisse du Chinois Sun Tzu (544 - 496 av. J.-C.) ou de l'Allemand Carl von Clausewitz (1780-1831). Cela l'a conduit a reprendre a nouveaux frais un des concepts-cle de la Guerre froide, celui de >, dans les deux ouvrages qui ont marque sa rupture avec le maoisme et le marxisme et en ont fait le chef de file des >, La Cuisiniere et le mangeur d'homme (Seuil) et Les Maitres-Penseurs (Grasset, 1977). Dans ce dernier ouvrage, il scrutait les origines de ce > chez les grands penseurs de l'Allemagne, de Hegel a Heidegger, voyant dans l'idealisme d'outre-Rhin la cause lointaine des malheurs du XXe siecle. Applaudi par Michel Foucault, ce tableau laissa a l'epoque sceptiques d'autres repentis de l'engagement communiste, comme l'historien Francois Furet.
Il s'ingenia ensuite a explorer la face sombre du nihilisme contemporain, comme dans son Dostoievski a Manhattan (Robert Laffont, 2002), ecrit dans la foulee des attentats du 11 septembre 2001. En cela, son oeuvre fut davantage marquee par l'intervention que par une production theorique.
- Nicolas Weill
Journaliste au Monde
En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/disparitions/article/2015/11/11/glucksmann-une-uvre-d-intervention-plus-qu-une-production-theorique_4807007_3382.html#iHK9QUT6lUe8gIIp.99
Desarrollado por LLIKA
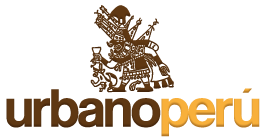
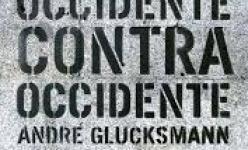
Comentarios recientes